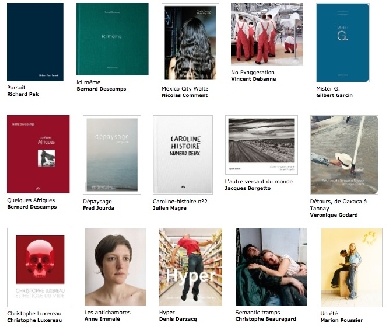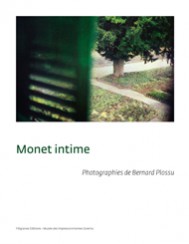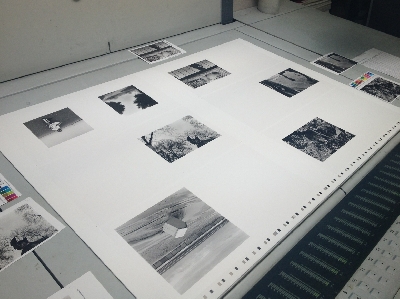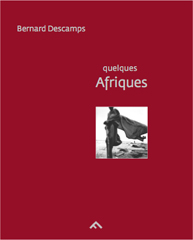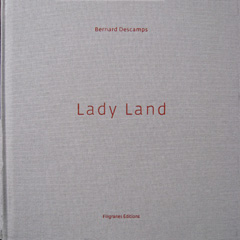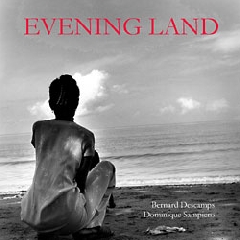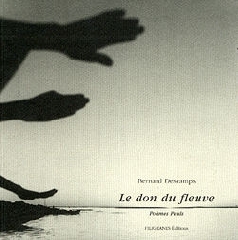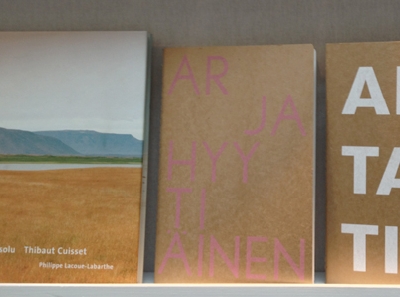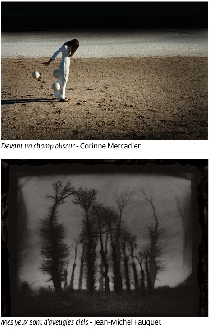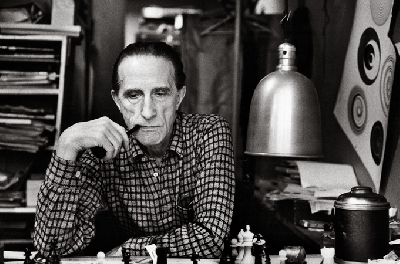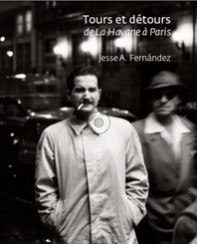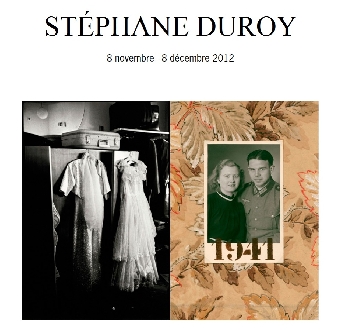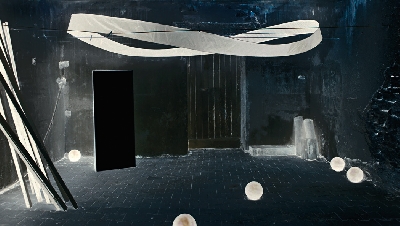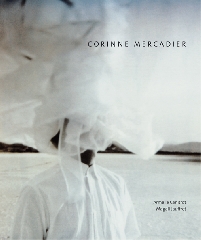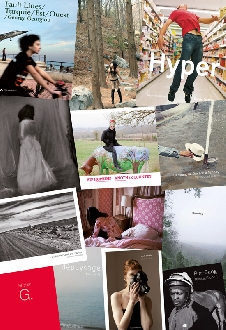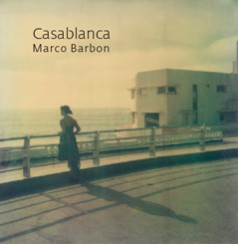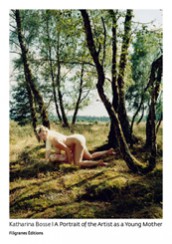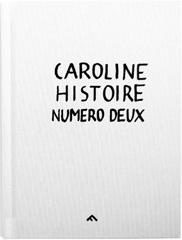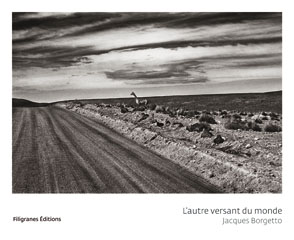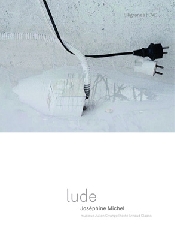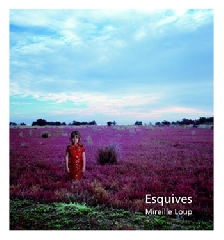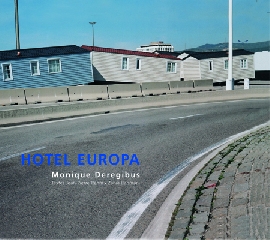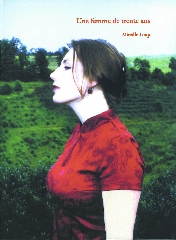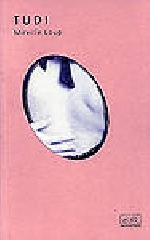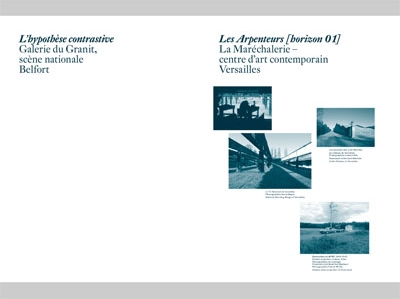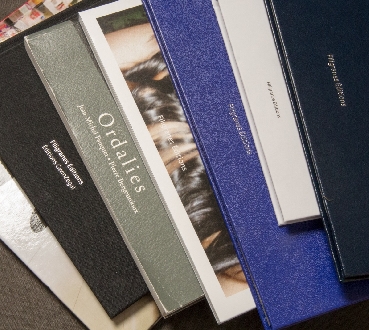
15 décembre 2012
Galerie Vu - Paris
Livres Filigranes chez VUMes yeux sont d’aveugles ciels
Jean-Michel Fauquet

Arja Hyytiäinen
Arja Hyytiäinen
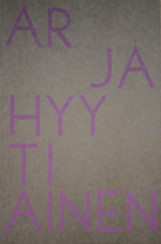
Geisterbild
Stéphane Duroy
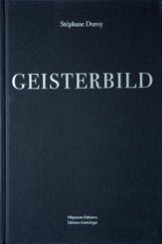
Chevaleresque
Rip Hopkins
Pauline de La Boulaye
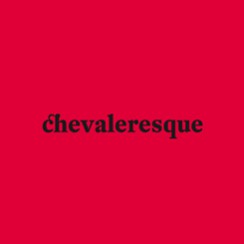
Le Mont Né
Jean-Michel Fauquet

Mexico City Waltz
Nicolas Comment
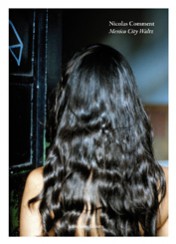
Un âge de Fer et de Béton
Rip Hopkins, Christophe Donner
Francis Saint-Genez

Distress
Stéphane Duroy
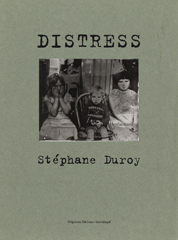
Le grand séparateur
Jean-Michel Fauquet
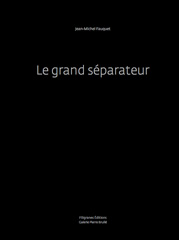
La visite
Nicolas Comment
Danielle Robert-Guedon

Hyper
Denis Darzacq
Amanda Crawley Jackson

Soft Machines
Richard Dumas
Philippe Garnier

Zone d’intervention précaire
Jean-Michel Fauquet
Francis Cohen

Saison # 21
Vince Taylor
Nicolas Comment
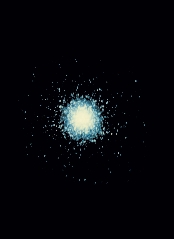
Saison # 16
Richard Dumas
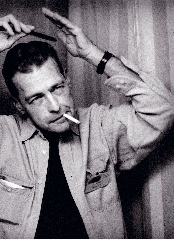
Ordalies
Jean-Michel Fauquet
Pierre Bergounioux


17 novembre 2012
Grand Palais
Paris Photo 2012Ali Taptik
Ali Taptik
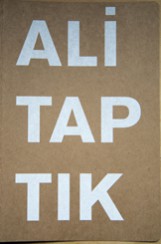
Arja Hyytiäinen
Arja Hyytiäinen
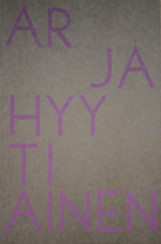
Good Dog
Yusuf Sevinçli

Companion
Charlotte Dumas
Michel Frizot, Paul Roth

Devant un champ obscur
Corinne Mercadier
Charles-Arthur Boyer

Pursuit
Richard Pak

Geisterbild
Stéphane Duroy
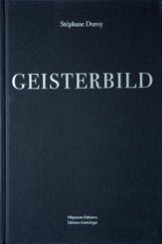
ici même
Bernard Descamps
Hervé Le Goff
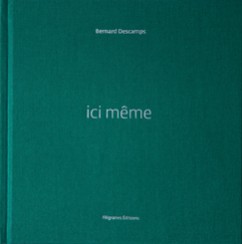
Logique de la mappemonde
Alexandre Castant
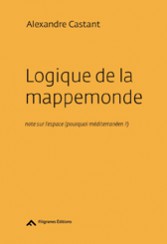
Le réel de la photographie
Arnaud Claass
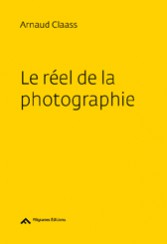
Le Mont Né
Jean-Michel Fauquet

Mexico City Waltz
Nicolas Comment
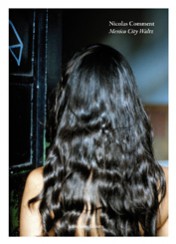
Mister G.
Gilbert Garcin
Natacha Wolinski


13 novembre 2012
Institut Néerlandais
Anima, Charlotte DumasCharlotte Dumas (1977) s’intéresse à la relation homme‐animal et sa place dans l’histoire. Elle est fascinée par les animaux et leur relation avec les êtres humains. Cette photographe présente ses modèles, (chiens policiers, chevaux, loups, tigres), avec un grand sentiment de présence et de caractère. Elle puise son inspiration entre autres chez des peintres du XIXe siècle comme Eugène Delacroix et Théodore Géricault. Attirée par l’héroïsme et la position des animaux dans l’histoire des humains, elle leur rend hommage par les portraits qu’elle réalise.
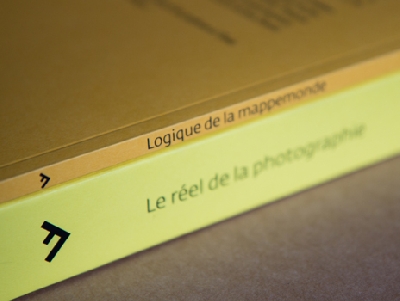
13 octobre 2012
Librairie Flammarion - Beaubourg
Rencontres/signatures avec Arnaud Claass et Alexandre Castant
15 juin 2012
L'Abbaye de Jumièges
Bernard PlossuL’abbaye de Jumièges est un des plus beaux et des plus étranges monuments de France. Après avoir été, dès sa fondation au VIIe siècle, un des monastères bénédictins les plus puissants de Normandie, elle est détruite, comme beaucoup d’établissements religieux, après la Révolution et transformée en carrière de pierre. Si deux tiers environ de ses bâtiments ont disparu, ses parties les plus importantes ont toutefois résisté à la démolition, en particulier son abbatiale romane, dont les tours privées de toitures dominent de près de 50 mètres un des méandres que la Seine forme en aval de Rouen.
A l’extérieur, le contraste est frappant entre cette architecture orgueilleuse et le calme du village de Jumièges entouré de ses plantations de fruitiers. A l’intérieur de l’enceinte, les jardins de l’abbaye, remodelés en parc à l’anglaise au XIXe siècle, forment un vaste paysage romantique où la végétation et les perspectives suggèrent une relation à la ruine toute différente.
En mai 2010, Bernard Plossu est venu voir l’abbaye de Jumièges. Les photographies qu’il a rapportées de cette visite font l’objet de cette exposition, installée pendant tout l’été 2012 dans les salons de l’abbaye. Les 39 tirages noir et blanc choisis par l’auteur dans deux formats de petite dimension, présentent comme une série de fragments du parc de l’abbaye, saisis au cours de sa promenade, par un temps couvert de printemps.
A l’extérieur, le contraste est frappant entre cette architecture orgueilleuse et le calme du village de Jumièges entouré de ses plantations de fruitiers. A l’intérieur de l’enceinte, les jardins de l’abbaye, remodelés en parc à l’anglaise au XIXe siècle, forment un vaste paysage romantique où la végétation et les perspectives suggèrent une relation à la ruine toute différente.
En mai 2010, Bernard Plossu est venu voir l’abbaye de Jumièges. Les photographies qu’il a rapportées de cette visite font l’objet de cette exposition, installée pendant tout l’été 2012 dans les salons de l’abbaye. Les 39 tirages noir et blanc choisis par l’auteur dans deux formats de petite dimension, présentent comme une série de fragments du parc de l’abbaye, saisis au cours de sa promenade, par un temps couvert de printemps.